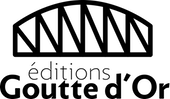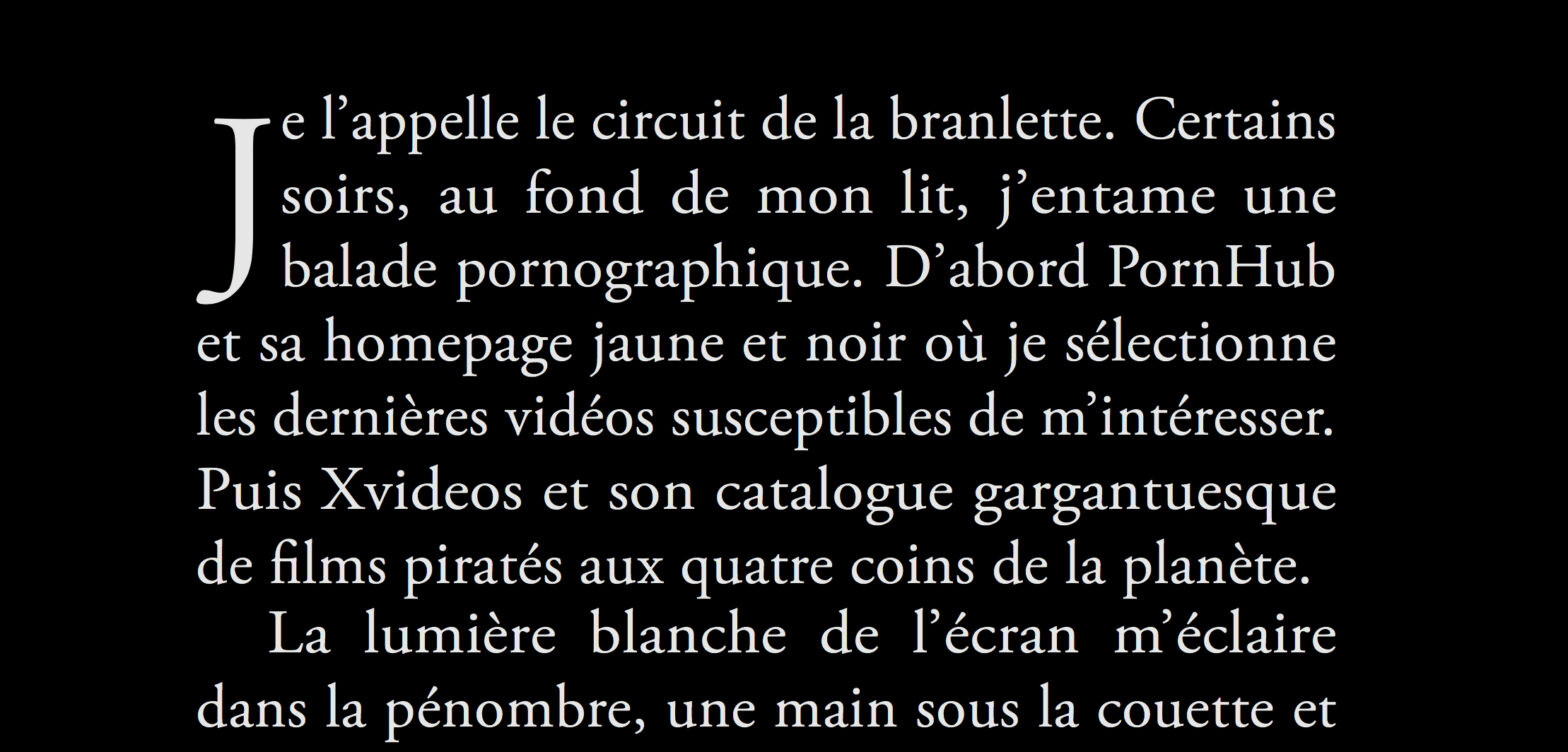Je l’appelle le circuit de la branlette. Certains soirs, au fond de mon lit, j’entame une balade pornographique. D’abord PornHub et sa homepage jaune et noir où je sélectionne les dernières vidéos susceptibles de m’intéresser. Puis Xvideos et son catalogue gargantuesque de films piratés aux quatre coins de la planète.
La lumière blanche de l’écran m’éclaire dans la pénombre, une main sous la couette et l’autre sur le pavé tactile. Rapidement, le flux généraliste des pages d’accueil m’ennuie. Trop plan-plan. Je file dans l’onglet « catégories » et affine mes recherches. Je sais ce qui m’excite. Des gorges profondes qui se finissent avec des actrices le visage dégoulinant d’eye-liner. Des gang-bangs qui laissent derrière eux des anus béants.
Je ne pense pas être misogyne. Je suis pour la répartition des tâches ménagères, pour l’égalité salariale entre hommes et femmes. Je peste dès qu’un mec siffle une fille en minijupe ou en moque une autre avec des poils sous les bras.
Cela dit, je jouis devant des vidéos où des hommes surjouent leur domination sur des femmes.
D’après les compteurs de vues, des millions de femmes et d’hommes font la même chose que moi. Je ne connais pourtant pas grand monde qui avoue se branler devant ce type de vidéos. Pas même mes amis les plus proches. Nous évitons tous le miroir tendu par nos fantasmes. Moi le premier.
Pourquoi ? Après tout, un fantasme reste du domaine de l’imaginaire et ne fait de mal à personne. Peut-on juger une scène dont l’action se déroule dans nos synapses ? « Ce qui se passe dans nos têtes nous appartient », écrit la chroniqueuse Maïa Mazaurette pour rassurer ses lecteurs et lectrices au sujet du fantasme du viol.
Sauf que le porno est un fantasme incarné. Il se construit autour d’une matière sensible. « Le porno se fait avec de la chair humaine, de la chair d’actrice, écrit l’écrivaine Virginie Despentes dans KingKongThéorie. Et au final, il ne se pose qu’un seul problème moral : l’agressivité avec laquelle on traite les hardeuses. »
En tant que journaliste et consommateur de porno, je me suis fixé un défi : passer de l’autre côté de l’écran. De janvier 2017 à mars 2018, j’ai infiltré le porno made in France.
Comment se fabriquent les vidéos qui me font bander ? Pourquoi des femmes consentent-elles à se faire éjaculer sur la figure devant une caméra ? Qui sont ces garçons au pénis dur comme du bois dont on voit rarement les visages ? Dans quelles poches atterrit l’argent généré ? Qu’est-ce que cela peut m’apprendre sur ma propre sexualité : l’officielle et l’officieuse ? Pourquoi le mouvement #MeToo s’est-il, pour le moment, arrêté aux portes de l’industrie pornographique ?
J’ai choisi le porno amateur, celui qui concentre la majorité de la production. « Mauvaise qualité d’image, absence d’éclairage, faible variété des angles de vue », le genre amateur selon la définition de François-Ronan Dubois, chercheur spécialiste des porn studies, est « avant tout le nom d’un style visuel, souvent marqué par un imaginaire voyeuriste et exhibitionniste ». Autre spécificité : des conditions de tournage low cost avec des budgets de quelques centaines d’euros et des actrices souvent sans notoriété.
Une entreprise incarne cette récente montée en puissance du porno amateur : Jacquie & Michel, une PME créée par un enseignant en 1999. La petite boîte annonce aujourd’hui 15 millions d’euros de chiffre d’affaires par an et concurrence Dorcel, le leader historique du secteur.
Le porno craint la lumière. Pour parvenir à mes fins, j’ai dû ruser. J’ai promis – et même publié – des articles complaisants dans Playboy. J’ai fréquenté un producteur endetté au point de ne plus savoir s’il s’agissait d’une source ou d’un ami. J’ai joué bénévolement un mari trompé dans un porno. J’ai tenu la caméra sur certains tournages et me suis improvisé agent pour un acteur débutant. J’ai enfilé une cagoule pour participer à un tournage où ma présence était interdite.
À force d’acharnement, j’ai pu suivre de l’intérieur l’éclosion de David ; les galères de Sofia pour mener à bien sa carrière ; le retour contraint de Judy, en manque de thunes. J’ai suivi l’acteur Scott dans sa cité, où il fait figure de vedette. J’ai attendu le client dans une chambre d’hôtel Ibis Styles avec Lola, la marathonienne du porno, zoophile à ses heures, qui trouve les animaux moins violents que les hardeurs. J’ai aussi croisé les starlettes Mia Foxx, Erika Saint-Laurent et Priscilla Gold.
Sofia, Judy et Lola. Ces trois actrices du porno amateur ont joué à leur insu un rôle central dans ma quête. À elles trois, elles incarnent différentes facettes du secteur et une panoplie de fantasmes. Ce sont les nouvelles Gorgones, ces trois sœurs de la mythologie grecque dont le regard pouvait pétrifier quiconque le croisait. Les corps dénudés de Sofia, Judy et Lola collent nos yeux à nos écrans et nos mains à nos sexes. Elles m’ont laissé m’immiscer dans leur intimité, leur enfance, leurs trajectoires souvent cabossées, leurs rêves.
Afin de raconter sans filtre les histoires des actrices et des acteurs – pourtant tous d’accord pour témoigner à visage découvert – leurs noms et pseudonymes ont été modifiés, de même que certains détails temporels, physiques et biographiques. En revanche, les producteurs et les réalisateurs, eux aussi d’accord pour être cités, conservent leur identité. Leur mise à nu relève, selon moi, de l’intérêt public, tant cette industrie est opaque. Et ne respecte pas toujours la dignité humaine.
À coups de stratégies et de combines, les actrices avancent dans un marécage aux lois édictées et appliquées par des hommes. Et justement, j’en suis un. J’en ai donc joué un maximum pour mettre en confiance ma confrérie sexuelle. Et ainsi approcher les vrais boss du secteur : les producteurs. Leur monde s’avère extrêmement hiérarchisé. Stéphane Prod et Kawato en bas de la pyramide. Juste au-dessus, Oliver Sweet, Célian, Pascal OP, John B. Root, puis Mat. Au sommet, le mastodonte, leur employeur à tous, le nouveau patron du porno français, aussi discret qu’une ombre : Michel, de Jacquie & Michel.
Dans ce monde parallèle, j’ai découvert que le droit du travail ne s’applique pas comme ailleurs. Un exemple parmi d’autres : il est fréquent qu’une actrice ne dispose pas d’un exemplaire du contrat qu’elle a signé. De même, le consentement s’achète ou se bafoue régulièrement.
Le secteur est un tabou de notre société. Intellectuels et politiques ont tendance à ne l’aborder que par le biais de la censure. « La pornographie a franchi la porte des établissements scolaires. Nous ne pouvons ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d’humiliation », tweetait le président Macron le 25 novembre 2017, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En 1975 déjà, le gouvernement instaurait le « classement X », censé éviter aux mineurs tout contact avec le cinéma pornographique. En fait, l’État ne s’intéresse au porno que pour le cacher et le stigmatiser.
Bien sûr, la censure ne s’applique jamais. Mais son ombre laisse libre cours à la loi du plus fort. Et depuis l’explosion des tubes (YouPorn, xHamster, Xvideo…), ces plateformes en ligne proposant gratuitement des millions de vidéos piratées, les conditions de travail des hardeuses se sont dégradées.
Les actrices sont le fuel du porno hétérosexuel ; elles sont également exécutantes de fantasmes mis en scène par des hommes, pour des hommes. Un même scénario tourne en boucle, comme une mauvaise pièce de théâtre se répétant à l’infini. Une femme et deux mecs. Une femme et trois mecs. Une femme et quatre mecs. Ça s’arrête à une femme et cinquante mecs. Ce dernier scénario s’appelle « bukkake », une douche de sperme faisant écho à un plat japonais dans lequel on verse de l’eau bouillante sur des nouilles.
Vous ne connaissiez que la face visible qui alimente nos écrans, nos fantasmes et nos branlettes ? En voici une autre.
Publié le